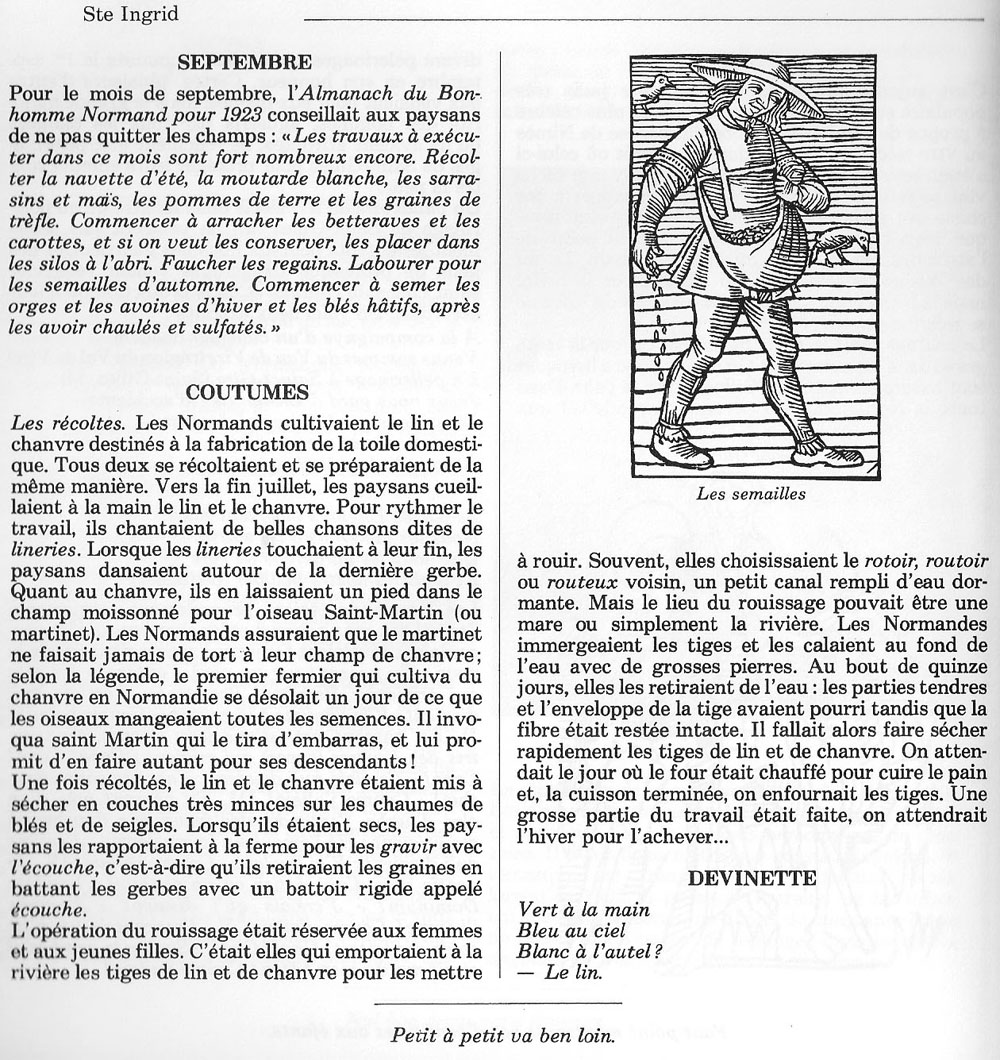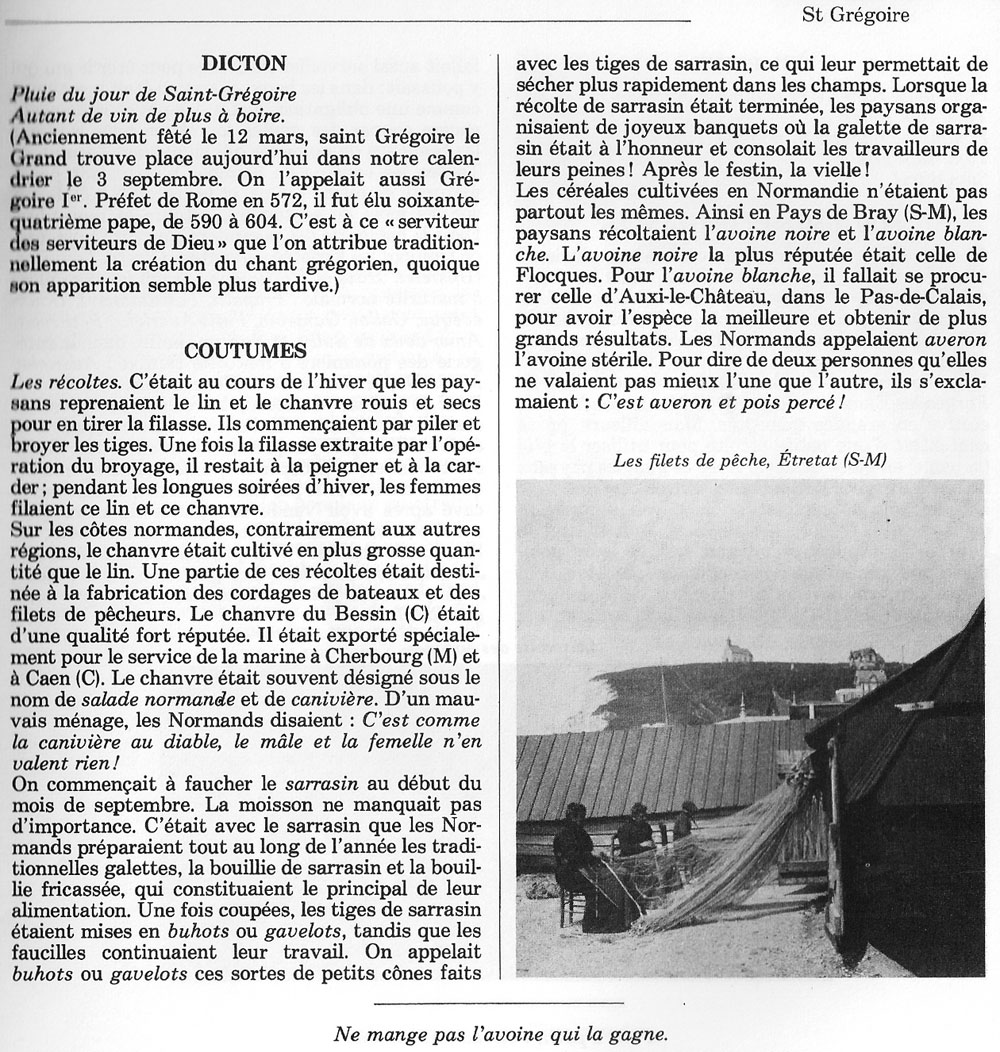le lin
Le Pays de Caux est le premier département producteur français et la France produit 80% du lin européen.
Première parution dans le Journal de Rouen du 10 février 1924. Texte établi sur l'exemplaire de la médiathèque (Bm Lx : norm 1496) de Par-ci, par-là : études d'histoire et de moeurs normandes, 4ème série, publié à Rouen chez Defontaine en 1927.
Le Tissage à la main en Normandie
~*~
* *
Le métier exposé sert au tissage des fils de lin, mais le tissage à la main se répandit surtout dans les campagnes et dans le Pays de Caux, quand le négociant Delarue - auquel Pierre Giffard voulait qu’on élevât une statue en or - eut fait filer 40 balles de coton, avec une chaîne de soie, bientôt remplacée par une chaîne de lin. Ne fut-il pas aussi l’inventeur de ces « siamoises » qui furent les premières rouenneries, répandues bientôt dans le monde entier, les Flandres, la Hollande, l’Espagne et ses colonies, nos Antilles françaises, sans compter les traitants de la côte d’Afrique. En 1787, la fabrique des toiles et des cotonnades de la Généralité était estimée à 500.000 pièces, valant par année de 45 à 50 millions de livres. Rouen qui possédait, en 1714, 1.581 métiers de siamoises, de fichus, de mouchoirs fil et coton, en possédait 3.495 en 1722.
Débordés par les commandes venues de toutes parts, c’est alors que l’industrie dut recourir, pour le filage et le tissage, à la main-d’oeuvre campagnarde. Mais ce ne fut pas sans mal, sans une lutte incessante. Les propriétaires campagnards, les fabricants des villes ne voyaient pas d’un bon oeil les villages ruraux se dégarnir de laboureurs, de journaliers et de domestiques. « On ne trouvait plus d’ouvriers pour réparer les granges, plus de vachers ou de bergers », si bien que les fermes étaient « désertes de bestiaux ». Par tous les moyens possibles, le Parlement protesta contre cet abandon de la terre par les ouvriers agricoles. Il alla même jusqu’à proposer « de faire défense dans la campagne de carder et de filer aucuns cotons, même de fabriquer aucunes étoffes ». Par contre, l’administration soutint les fabricants et les ouvriers agricoles et s’opposa aux mesures trop draconiennes proposées par le Parlement, trouvant qu’il y avait intérêt à diminuer les prix de revient des objets fabriqués et à garder les bras nécessaires pour assurer la moisson.
Tous ces artisans campagnards, vers 1780, au beau temps de l’industrie textile, étaient surtout des fileurs et des fileuses au rouet, et leur nombre dépassait de beaucoup celui des tisserands. Des 188.217 personnes rémunérées par la toilerie aux environs de Rouen, presque toutes étaient occupées à filer, surtout les femmes, les enfants, les infirmes qui n’avaient point besoin d‘apprentissage pour exercer ce métier. Les tisserands étaient donc moins nombreux et formaient un peu l’aristocratie du métier, mais ils étaient partout répandus dans tout le Pays de Caux. Arthur Young, à la veille de la Révolution, écrivait : « Tout le plateau, depuis Rouen, est un district plutôt manufacturier qu’agricole. Dans les ressources de ses habitants, la ferme vient après la fabrique. » Bientôt toute cette belle fabrique normande fut très menacée, à la suite du traité de commerce avec l’Angleterre en 1786, qui inonda le marché des étoffes de coton fabriquées à la machine, avec les tissages mécaniques créés par Hargreaves et surtout par Artwight, en 1760. Il fallut que l’antique rouet cédât devant la jenny d’Hargreaves et devant les machines créées par ce Brisout de Barneville, dont le nom a été donné à une rue de Rouen. Ce fut l’emploi de cet outillage nouveau, encouragé par Alexandre de Fontenay en 1786, par Pouchet, par Lemaître à Lillebonne, en 1802, qui détermina la concentration dans les usines de la filature, jusqu’alors dispersée dans les campagnes.
* *
La disparition de la filature du coton à domicile, remplacée par le machinisme, venu de chez nos bons amis les Anglais, n’entraîna pas immédiatement la disparition du tissage à la main. Tout au contraire. La production des filés ayant augmenté, le tissage à la main augmenta en proportion. Les étoffes, par suite, devinrent plus belles et surtout plus variées. On en vint à imiter les tissus des Indes, à perfectionner le calicot, le madapolam. Yvetot, capitale du pays de Caux et les lieux circonvoisins, Autretot, Veauville-les-Baons, Bolbec, connurent alors une ère de prospérité extraordinaire.
Mais elle ne se maintint pas toujours, et, au cours du dix-neuvième siècle, le tissage à la main, dans les campagnes normandes, eut à subir bien des alternatives et des crises. La paix d’Amiens, en 1802, avait ramené l’activité et maintenu les salaires. La reprise des hostilités contre l’Angleterre, le blocus du Havre, interdirent l’arrivée des cotons en Normandie, en même temps qu’ils privaient notre industrie textile de ses débouchés aux Antilles, où se vendaient aux noirs tant de siamoises et de beaux madras. L’exportation des toiles bleues et des guinées, des gingats sur la côte d’Afrique, si active avant la Révolution, subit aussi le même sort.
Pendant toute la durée de l’Empire, la production redevint considérable, même réduite au marché français, à cause du Blocus continental, interdisant presque partout en Europe les produits anglais : tout au plus si les innombrables guerres raréfièrent la main-d’oeuvre et dut-on, pour remplacer les solides gars cauchois enrégimentés dans les armées napoléoniennes, employer les femmes et les enfants, qu’on se disputait alors à coups de salaires. En 1814, dit Sion, dans sa belle étude Les paysans de la Normandie orientale, les salaires des tisserands montèrent à cinq francs par jour. Il y eut alors une poussée formidable. Tous les paysans apprirent à tisser. Comme autrefois, lors de la prospérité du filage, on ne trouvait plus de charpentiers, de maçons, de couvreurs. Les populations côtières, du côté de Saint-Valery et de Fécamp, se mirent à tisser. L’entraînement était si grand qu’on dut recourir à la main-d’oeuvre des tisserands de l’Artois et du Cambrésis, où toutes les semaines, des rouliers allaient porter les chaînes, les tissures et… les salaires. Eugène Noël, le charmant écrivain rouennais, dans son Rouen, Rouennais et Rouenneries, a raconté un voyage qu’il fit tout enfant, dans une de ces voitures, se rendant aux environs de Dieppe. D’autres convois allaient jusqu’à Péronne et Amiens. A un moment, en 1828, le préfet de la Seine-Inférieure, le baron de Vanssay, craignit même que toute la main-d’oeuvre de l’industrie textile abandonnât la Seine-Inférieure, pour refluer vers le Nord. L’industrie lainière suivit alors la même progression et, malgré l’introduction de la machine, les tisserands à la main, dont on peut encore voir l’antique métier représenté sur les beaux vitraux de la pauvre église Saint-Etienne d’Elbeuf, se répandirent encore aux environs d’Elbeuf, de Louviers, de Darnétal.
Pendant une longue période, le tissage à la main, industrie familiale, s’étendit de plus en plus dans la campagne normande, mais eut à subir quelques crises, de 1830 à 1832, au moment de l’épidémie de choléra qui raréfia la main-d’oeuvre, surtout dans les villes ouvrières, en 1839, en 1842 et aux approches de la Révolution, et des émeutes de Rouen, de 1842 à 1849.
* *
A quel nombre, pendant ces moments de prospérité, s’éleva le chiffre des tisserands ? C’est une question assez difficile à résoudre, parce qu’on confond généralement, dans les statistiques, tous les ouvriers du coton, les fileurs et les tisserands.
A la fin de 1833, P. S. Lelong, dans ses Aperçus historiques sur l’industrie cotonnière, avance qu’il y avait, dans la Seine-Inférieure, 65.000 tisserands, et dix ans après, Lecointe, en 1842, réduit ce nombre à 30.500 seulement, différence qui rend ces évaluations assez douteuses. La mévente de 1842 ne suffit pas, en effet, à établir cette différence. Dans la Seine-Inférieure industrielle et agricole, Corneille dit qu’au temps le plus florissant de la rouennerie, l’industrie textile se chiffrait par un produit de 86 millions et que la main-d’oeuvre figurait dans cette industrie pour 34 millions. Il estimait le nombre des ouvriers au métier à 45.340, hommes, femmes et enfants. Lors de la crise cotonnière, en 1862, l’enquête ordonnée semble avoir établi que la Seine-Inférieure comptait 81.239 ouvriers, « occupés en temps normal », dont les familles représentaient, dit Sion, 223.754 personnes, soit un tiers de la population ».
Comment étaient particulièrement répartis les tisserands à la main, en dehors des centres de filature ? La plus grande partie occupait tout un large quadrilatère, qui correspond actuellement à la plus grande partie du Pays de Caux. Il était limité par la mer, au Nord ; par la route de Fécamp à Bolbec, à l’est ; par une ligne allant de Bolbec jusqu’à Yvetot et à Tôtes, au sud, et une ligne remontant de Tôtes jusqu’à Dieppe, à l’ouest. Pas une bourgade où, au beau temps du tissage à la main, on n’entendît claquer la navette. Un tiers des habitants de ces villages cossus et riches alors dépendait de l’industrie textile.
Dans le reste du département, le tissage à la main était moins répandu. A l’extrémité du département, dans ce qu’on nommait au Moyen-Age, le grouin de Caux, il n‘y avait que cinq ou six communes, comptant une centaine de tisserands. Rien dans le canton de Montivilliers. A l’Est, dans le pays de Bray, dans les vallées de la Varenne, de la Bresle, de la Béthune, peu ou point d’industries textiles. Il fallait rejoindre la vallée de l’Andelle pour retrouver quelques centres de tisserands, groupés autour des usines.
Par une anomalie qui s’explique, autour de Rouen, il n’y avait que peu de tisserands à la main. Ceux-ci, étant généralement alors mal payés, préféraient être ouvriers fileurs dans les manufactures de Rouen, de Maromme, de Pavilly, où les salaires étaient plus élevés. L’introduction des chemins de fer, d’autre part, et l’établissement des principales lignes ferrées dans le département, n’eut aussi aucune influence sur la distribution des centres ruraux de tissage à la main et sur la multiplication des métiers à tisser. L’expansion des tisserands au métier dans le pays de Caux, avait été due surtout au « roulage » facile sur un pays plat, sillonné de bonnes routes dans tous les sens et aussi au peu de poids des étoffes transportées.
* *
Quelle était la vie du tisserand campagnard, lors de l’apogée du tissage à la main dans les campagnes ? A l’époque du filage au rouet, dont nous avons parlé, l’union du travail des champs et du travail industriel était complète. Elle le fut moins, avec le tissage à la main.
Le prix d’un métier n’était pas très cher, 100 à 150 francs à Rouen en 1836, mais il était plus cher cependant que l’achat d’un rouet. De plus, il fallait au moins, d’après les Mémoires de l’ouvrier Noiret, un an d’apprentissage pour acquérir une véritable habileté technique.
Ce sont ces deux conditions qui créèrent peu à peu une classe d’artisans distincte de la classe agricole. Le tisserand n’était pas un ouvrier accidentel comme on est porté à le croire, c’était bien un ouvrier spécialisé. Quelques journaliers demandaient bien à l’industrie cotonnière un supplément de ressources, mais c’était la minorité. En 1851, dans le canton de Fauville, d’après les tableaux de recensement, ces ouvriers « à deux mains » étaient 210 contre 3.600 tisserands, fileuses, trameurs et trameuses de profession. Le tissage n’était donc pas une industrie de secours, un métier d’hiver, mais le gagne-pain de l’année. Tout au plus le tisserand cauchois abandonnait-il son métier pendant la moisson, où il se transformait en aoûteux, du mois de juin ou d’août jusqu’en octobre. Ces mois passés au grand air et au soleil étaient, pour eux, une station, une halte dans leur métier, presqu’un repos, sans compter qu’ils procuraient quelques profits en dehors de leurs salaires.
Plusieurs économistes, comme Sion, comme Levainville, dans son beau livre sur Rouen, ont décrit la vie intérieure et l’habitation du tisserand campagnard.
« Aux environs d’Yvetot ou d’Héricourt, les maisons allongées, dit Sion, se terminent par une pièce plus éclairée que les autres. Le jour entre par d’étroites ouvertures, ménagées entre les poutrelles verticales qui soutiennent les murs de pise. Ces verrines sont la marque distinctive de la maison du tisserand. Pour garder aux filés l’humidité, sans laquelle ils casseraient à chaque instant, il n’était pas obligé de mettre son métier dans une cave, comme dans certains villages du Cambrésis. L’air du pays de Caux n’est jamais trop sec. La maison où il travaillait était donc de plain-pied avec le reste. Sur l’aire de terre battue, au-dessous des grosses lampes qui éclairaient les veillées laborieuses, il y avait souvent place pour deux métiers au moins. Toute la famille du tisserand était, en effet, associée à son travail. Tant que le soin de ses enfants ne la réclamait pas impérieusement, la femme fabriquait les étoffes, calicots, mouchoirs, dont la confection exige le coup de balancier le moins vigoureux. Les enfants même étaient occupés à dévider les écheveaux de fils de trame et à les enrouler sur les fuseaux de la navette, que, dès 10 ou 11 ans, garçons ou filles apprenaient à lancer, suivant un manuscrit de l’ouvrier Bion, conservé à la Bibliothèque de Rouen. Le tisserand avait trop besoin d’aide pour ne pas garder ses enfants à l’atelier. Ils ne vivaient donc pas toujours au grand air comme les fils des paysans. L’industrie familiale ne fut donc pas toujours une idylle ».
En passant, indiquons qu’en Angleterre, dès le XVIIIe siècle, l’industrie textile domestique entraîna la pire exploitation de l’enfance. Malgré tout, si puissante est la force d’épargne paysanne, que les tisserands à la main, surtout sous le premier Empire, parvinrent à devenir propriétaires de leurs maisons ou d’une petite ferme ; de même aussi, vers 1834, quelques tisserands de laine, aux environs d’Elbeuf. Enfin, on signale l’association de quelques paysans, dans le canton des Loges ou de Montivilliers, pour l’acquisition de petits domaines où ils cultivaient le lin, qu’ils rouissaient, teillaient, filaient et tissaient. Mais cette union de la culture et de l’industrie fut toujours rare chez le tisserand de cotonnades et de rouenneries.
* *
L’un des agents essentiels de cette organisation du travail dans les campagnes était le porteur. C’était un type mi-paysan, mi-ouvrier, très curieux, très gai, très « allant », aujourd’hui à peu près disparu et qu’on ne retrouve plus que dans quelques croquis ou lithographies d’Hippolyte Bellangé. C’était le messager souvent courtier et cultivateur, qui venait chaque semaine chercher dans les dépôts des fabricants, les chaînes, les tissures, souvent fabriquées dans les vieux logis à étentes de la rue Eau-de-Robec, pour les distribuer aux tisserands cauchois. Avec une probité proverbiale, il rapportait ensuite les pièces confectionnées aux fabricants en gros. Ils avaient leurs habitudes, leurs coutumes, leurs traditions. Ils correspondaient entre eux, par des coups de fouet sonores qui retentissaient sur les routes. Eugène Noël, qui avait connu toute cette vie des rouliers et des porteux cauchois, avait même recueilli quelques-unes de leurs chansons de route, et il a décrit d’une façon très colorée, l’arrivée des porteux du Pays de Caux, la veille du vendredi, dans les grandes halles aux toiles et aux rouenneries de la Haute-Vieille-Tour, à Rouen.
* *
Le progrès mécanique devait entraîner la disparition du tissage à la main. Chose curieuse, le premier tissage mécanique, composé d’une cinquantaine de métiers, fut monté à Fécamp, et en 1834, il y avait déjà, dans la Seine-Inférieure, 600 métiers à tisser. De 1840 à 1850, la décadence du tissage à la main s’accusa tout d’abord sur le littoral, de Fécamp au Havre, région qui avait toujours résisté à l’introduction de l’industrie textile, et où les artisans revinrent, pour la plupart, à la pêche. Cette industrie rurale résista mieux au centre du pays de Caux, bien que les petits fabricants campagnards, possesseurs de petits capitaux, étaient souvent ruinés les premiers.
Dès 1854, le préfet Le Roy affirmait que « le tissage à la main était condamné à disparaître, bien qu’il luttât en désespéré contre l’industrie des manufacturés ». Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, la grande crise cotonnière de 1863 fut plus désastreuse pour la filature que pour ce tissage individuel, et encore, en 1873, d’après Corneille, le nombre des métiers à la main dépassait celui des métiers mécaniques, 60.000 contre 12.764. Peu à peu cependant, la décadence s’accentua avec les nouveaux produits de Roanne et de Roubaix, qui venaient concurrencer nos rouenneries sur le marché colonial ; le tissage du lin disparut aussi à cette époque du canton de Montivilliers. Les statistiques relevées par Sion montrent que dans le canton de Yerville, on trouvait en 1906 : 17 ouvriers à Etouteville, au lieu de 150 en 1863 ; plus un seul à Ancretiéville-Saint-Victor et à Saint-Martin-aux-Arbres, au lieu de 1015 ; un seul à Vibeuf au lieu de 3.801. A cette époque, Gustave Hutu, dans son Rapport sur l’industrie textile à Yvetot, fixait à 14 francs environ le salaire des bons ouvriers tisserands par semaine, pour un travail de 12 heures par jour.
La disparition des tisserands n’est pas encore complète et il y a toujours des métiers aux environs d’Yvetot, dans quelques communes où l’on façonne encore parfois des burnous, des haicks, des mouchoirs, des ceintures orientales. Parfois encore quand les autos ralentissent un peu dans la traversée d’un village cauchois isolé, on entend encore le bruit de la navette qui résonne. L’électrification départementale ne peut-elle apporter quelque modification dans cette industrie familiale ?
|
Le coton dans la campagne normande au XVIIIième siècle |
Depuis le moyen-âge, on sait travailler la laine et le lin et vers 1700 beaucoup de métiers sont répandus dans la campagne. A l'exception des draps fins produits dans les villes drapières de Rouen, Darnétal, Elbeuf et Louviers , tout se fait dans les campagnes note l'intendant d'Herbigny en 1704.
Le coton est peu utilisé même si en 1679 Jean Launay cirier à Bolbec possède un rouet à filer le coton nécessaire pur confectionner les mèches des chandelles.
rouet (roet au XIII siècle):machine à filer constituée d'une petite roue mue par une pédale ou une manivelle et par une broche à ailettes. Il a remplacé la quenouille .
En 1701, un négociant de Rouen, Delarue, ne pouvant se débarrasser de 40 balles de coton brut,décide de le faire travailler par des ouvriers locaux. Le fil est trop fragile pour des mains inexpérimentées et Delamare a l'idée de renforcer le coton de trame par une chaîne de soie puis par une trame de lin.C'est l'étoffe nommée"siamoise" dont le nom rappelle les tissus orientaux très à la mode. Puis, ce sera les" indiennes", les "andrinoples".
siamoise:étoffe de coton et de soie apportée à Louis XIV par les ambassadeurs du Siam
indienne:toile de coton peinte ou imprimée très souvent avec de l'alapin
andrinople:étoffe de coton teinte en rouge turc ou d'Andrinople
On a appelé "rouenneries" les tissus en laine ou coton dont les dessins ou effets de reliefs résultaient de l'agencement des fils teints avant le tissage.
Pour satisfaire les commandes, Rouen tisse, blanchit et teinte mais le filage donne naissance à une véritable industrie rurale.Les journaliers vont adopter ce travail traditionnellement réservé aux femmes et aux enfants, délaissant le travail de la terre. L'ouvrier, payé à la tâche, peut organiser librement son travail, moins salissant même que celui de la laine ou du lin,mieux payé,à l'abri des intempéries,sans être surveillé par un fermier . De plus,cette main d'oeuvre a l'avantage d'être plus docile que les ouvriers des villes, coûte moins cher (on accepte d'être moins payé car on tire des ressources de son champ) et permet de violer les règlements des corporations. Des "maisons" se retrouvent sans domestiques, les fermiers sans laboureurs, sans bergers,sans vachers et les forêts royales manquent de bûcherons.
production de pièces de coton (Rouen)
|
1717 |
60 200 pièces |
|
1732 |
166 750 pièces |
|
1743 |
435 000 pièces |
|
1780 |
538 000 pièces |
Le coton vient des Indes Occidentales (St Domingue,Guadeloupe). Le port de Rouen envoie dans tout le royaume ses siamoises, ses andrinoples, ses indiennes, les draps de laine de Louviers et Elbeuf car le fleuve est plus sûr que la route.On exporte en Belgique, en Hollande et en Allemagne.